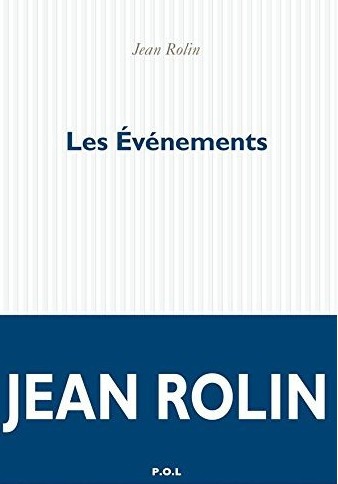La guerre civile froide ?
Les dernières péripéties, pour ne pas dire les galipettes, de François Hollande ont eu tendance à masquer un instant le sérieux de la situation dans le pays en ce début d’année. Il est vrai que notre Président casqué se rendant à la nuit dans le lit de sa blonde rejoue, mais sur le mode dérisoire et un peu ridicule, les grands mythes de l’Antiquité. Le fait que ce lit soit dans un appartement d’une personne liée au gang de la Brise de Mer ajoute ici ce qu’il faut de sordide à la parodie. L’important n’est cependant pas là ; mais l’important existe bien.
On peut se demander si, en France, nous ne vivons pas actuellement les prémices d’une guerre civile. Cette question, en apparence absurde, mérite cependant d’être posée à la vue des événements que l’on a connus ces dernières années. Dans une note datant de l’automne 2012, j’évoquais la possibilité de la crise de légitimité du pouvoir. Nous y sommes désormais. L’année 2014 risque fort d’être marquée par une accumulation de mouvement sociaux dont la convergence mettrait directement en cause le pouvoir. Or, la crise de légitimité a ceci de particulier qu’elle pose directement la question non pas de la politique suivie, que l’on peut en fonction de ces opinions considérer comme bonne ou mauvaise, mais du fait que le pouvoir soit habilité à mener une politique. C’est pourquoi il faut s’attendre à ce que la contestation du pouvoir puisse prendre un tour violent dans le cours de cette année.
En fait, l’exercice du pouvoir, la Potestas, dépend de sa légitimité que lui confère l’Auctoritas. Ces notions, habituelles sous la plume des juristes d’inspiration chrétienne, ne sont pourtant nullement liées obligatoirement à cette sphère. On comprend bien, même intuitivement, la nécessité de séparer la capacité à exercer un pouvoir politique de la légitimité, ou de la justesse, qu’il y a à le faire. Il n’est donc pas nécessaire d’être chrétien, ni même de croire en Dieu, pour remarquer la pertinence de la distinction entre Auctoritas et Potestas.
Cette question est d’habitude passée sous silence, parce que nul ne conteste la légitimité du pouvoir, surtout d’un pouvoir issu d’institutions qui sont en théorie démocratiques. Mais, force et de constater que l’opposition au pouvoir, qu’elle vienne de la droite ou de la gauche, est désormais moins une opposition à ce que fait ce pouvoir qu’un opposition à sa capacité même à faire.
La violence politique, fille de l’illégitimité
La vie politique française est en effet marquée depuis quelques années par une incontestable montée du niveau des affrontements, qu’ils soient verbaux, symboliques, et parfois même physiques. Nous vivons, en réalité, l’équivalent des prémices d’une guerre civile « froide », qui menace à chaque instant de se réchauffer. L’ex-Président, Nicolas Sarkozy, en a fait l’expérience durant son mandat, et en particulier à partir de 2009-2010. Il fut l’objet d’attaques dont le caractère haineux ne fait aucun doute, et qui provenaient – ce fait est à noter – tant de la gauche, ce qui peut être compréhensible, que de la droite. On a mis ces attaques sur le compte du « style » imposé par ce Président, dont les dérapages verbaux et les outrances étaient légions, et qui tendait à ramener toute action, et donc tout mécontentement, à lui seul. Ce n’était pas pour rien que l’on parlait d’un « hyper-président », rejetant – au mépris de la constitution – son Premier ministre dans l’ombre. Cependant, l’élection de son successeur, François Hollande, se présentant comme un Président « normal », n’a rien changé à cette situation. On peut, par ailleurs, s’interroger sur le qualificatif de « normal » accolé à Président. La fonction présidentielle est tout sauf « normale ». Que le style de l’homme puisse se vouloir « modeste » est plausible, surtout après les outrances, et les Fouquet’s et Rolex de son prédécesseur. Mais il faut bien constater que rien n’y fit. L’opinion, jamais charmée par l’homme qui dès son élection n’a pas eu « d’état de grâce » comme les autres Présidents, s’en est rapidement détournée. Le voici au plus bas des sondages, voué aux gémonies sans avoir jamais été encensé. Tout est prétexte, à tort ou à raison, à reproches et critiques. Il se voit désormais contester par certains la possibilité même de gouverner. Comme son prédécesseur, il fait l’objet de critiques dévastatrices parfois même dans son propre camp politique qui vont bien au-delà de sa simple personne. Les mouvements sociaux, qui sont naturels dans un pays et dans une société qui sont naturellement divisés, prennent désormais des dimensions de plus en plus violentes et radicales. Après la « manif pour tous », voici les « bonnets rouges ».
On a dit, et ce n’est point faux, que la présence de la crise, la plus significative que le capitalisme ait connu depuis les années 1930, expliquait cette tension. Mais, même si cette crise est exemplaire, le pays en a connu d’autres depuis les années 1980. Il faudrait, pour retrouver ce même état de tension, revenir à la fin des années 1950 et à la guerre d’Algérie. Mais l’on sait, aussi, que la IVème République était devenue largement illégitime. De même, on explique souvent, et pas à tort, qu’Internet est devenu un lieu ambigu, entre espace privé et espace publique, qui est particulièrement propice à la libération d’une parole autrement et autrefois réprimée. Cette explication, même si elle contient sa part de vérité, ne tient pourtant pas face à la spécificité de la crise française. En effet, les effets d’Internet sont les mêmes dans tous les pays développés. Or, du point de vue de la violence politique, pour l’instant essentiellement symbolique, mais dont on pressent qu’elle pourrait se développer en une violence réelle, il y a bien une différence entre la France et ses voisins. Il faut donc aller chercher plus en amont les sources de cette radicalisation et surtout voir qu’au-delà de l’homme (ou des hommes) – aussi ridicule voire haïssable qu’il puisse être – elle touche à la fonction et au système politique dans son entier. Nous vivons, en réalité, une crise de légitimité.
Cette crise se manifeste dans le fait que l’on conteste non plus la politique menée, ce qui est normal en démocratie, mais l’exercice même de la politique tant par l’UMP que par le PS. Désormais la distinction, largement factice la plupart du temps, entre le pouvoir et le pays réel, devient une réalité. Cette opposition n’est pas sans rappeler celle entre « eux » et « nous » (Oni et Nachi) qui était de mise dans les régimes soviétiques lorsque le système a commencé à se bloquer. Toute personne qui a travaillé sur les dernières années du système soviétique, tant en URSS que dans les pays européens, ne peut qu’être sensible à cette comparaison. La perte de légitimité était, là, liée à la combinaison de problèmes économiques (la « stagnation ») et politiques, dont l’origine vient de l’écrasement du réformisme soviétique à Prague en août 1968.
En France, cette perte de légitimité du système politique et du pouvoir, dont nous voyons les effets se déployer de manière toujours plus désastreuse devant nos yeux, a une cause et un nom : le référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne. Les référendums sur l’Europe ont toujours été des moments forts. Contrairement à celui sur le traité de Maastricht, où le « oui » ne l’avait emporté que d’une courte tête, le « non » fut largement majoritaire en 2005 avec 55% des suffrages. Pourtant, ce vote fut immédiatement bafoué lors du Traité de Lisbonne, signé en décembre 2007 et ratifié par le Congrès (l’union de l’Assemblée nationale et du Sénat) en février 2008. De ce déni de démocratie, qui ouvre symboliquement la Présidence de Nicolas Sarkozy, date le début de la dérive politique dont nous constatons maintenant la plénitude des effets. La démocratie dite « apaisée », dont Jacques Chirac et Lionel Jospin se voulaient être les hérauts, est morte. Nous sommes entrés, que nous en ayons conscience ou pas, dans une guerre civile « froide ».
La souveraineté, la légitimité et la légalité
Ce déni a réactivé un débat fondamental : celui qui porte sur les empiètements constants à la souveraineté de la Nation et par là à la réalité de l’État. Ces empiètements ne datent pas de 2005 ou de 2007 ; ils ont commencé dès le traité de Maastricht. Mais, le déni de démocratie qui a suivi le referendum de 2005 a rendu la population française plus réceptive à ces questions. Ceci est aussi dû à l’histoire politique particulière de notre pays. La construction de la France en État-Nation est un processus qui remonte en fait au tout début du XIIIème siècle, voire plus loin. On peut prendre comme événement fondateur la bataille de Bouvines (27 juillet 1214), qui a marqué le triomphe d’un roi « empereur en son royaume » face à ces ennemis, les trois plus puissants princes d’Europe (Othon IV de Brunswick, Jean Sans Terre et Ferrand de Portugal). La culture politique française a intégré ce fait, et identifie le peuple et son État. Plus précisément, le processus historique de construction de la souveraineté de la Nation française n’a été que l’autre face du processus de construction de la communauté politique (et non ethnique ou religieuse) qu’est le peuple français . À cet égard, il faut comprendre à la fois la nécessité d’une Histoire Nationale, fondatrice de légitimité pour tous les pays, et le glissement, voire la « trahison » de cette histoire en un roman national. Suivant les cas, et les auteurs, ce « roman », qui toujours trahit peu ou prou l’histoire, peut prendre la forme d’un mensonge (du fait des libertés prises par ignorance ou en connaissance de cause avec la réalité historique). Mais ce mensonge est nécessaire et parfois il est même salvateur en ceci qu’il construit des mythes qui sont eux-mêmes nécessaires au fonctionnement de la communauté politique. Toute communauté politique a besoin de mythes, mais la nature de ces derniers nous renseigne sur celle de cette communauté.
La souveraineté est indispensable à la constitution de la légitimité, et cette dernière nécessaire pour que la légalité ne soit pas le voile du droit sur l’oppression. De ce point de vue il y a un désaccord fondamental entre la vision engendrée par les institutions européennes d’une légalité se définissant par elle-même, sans référence avec la légitimité, et la vision traditionnelle qui fait de la légalité la fille de la légitimité. Cette vision des institutions européennes aboutit à la neutralisation de la question de la souveraineté. On comprend le mécanisme. Si le légal peut se dire juste par lui-même, sans qu’il y ait besoin d’une instance capable de produire le juste avant le légal, alors on peut se débarrasser de la souveraineté. Mais, sauf à proclamer que le législateur est omniscient et parfaitement informé, comment prétendre que la loi sera toujours « juste » et adaptée ? Ceci est, par ailleurs le strict symétrique de la pensée néoclassique en économie qui a besoin, pour fonctionner et produire le néo-libéralisme, de la double hypothèse de l’omniscience et de la parfaite information. La tentative de négation si ce n’est de la souveraineté du moins de sa possibilité d’exercice est un point constant des juristes de l’Union Européenne. Mais ceci produit des effets ravageurs dans le cas français.
La question de l’identité
Dès lors, une remise en cause de la souveraineté française prend la dimension d’une crise identitaire profonde mais largement implicite, pour une majorité de français. Dans cette crise, les agissements des groupuscules « identitaires » ne sont que l’écume des flots. Les radicalisations, qu’elles soient religieuses ou racistes, qui peuvent être le fait de certains de ces groupuscules, restent largement minoritaires. Les Français ne sont pas plus racistes (et plutôt moins en fait…) que leurs voisins, et nous restons un peuple très éloigné des dérives sectaires religieuses que l’on connaît, par exemple aux États-Unis.
Mais, le sentiment d’être attaqué dans l’identité politique de ce qui fait de nous des « Français » est un sentiment désormais largement partagé. La perte de légitimité de ceux qui exercent le pouvoir, qu’ils soient de droite ou de gauche, peut se lire comme un effet direct de l’affaiblissement de l’État qui découle de la perte d’une partie de sa souveraineté. On mesure alors très bien ce que la légitimité doit à la souveraineté. Non que l’illégitimité soit toujours liée à la perte de souveraineté. Des pouvoirs souverains peuvent s’avérer illégitimes. Mais parce qu’un pouvoir ayant perdu sa souveraineté est toujours illégitime. Or, la légitimité commande la légalité. On voit ici précisément l’impasse du légalisme comme doctrine. Pour que toute mesure prise, dans le cadre des lois et des décrets, puisse être considérée comme « juste » à priori, il faudrait supposer que les législateurs sont à la fois parfaits (ils ne commettent pas d’erreurs) et omniscients (ils ont une connaissance qui est parfaite du futur). On mesure immédiatement l’impossibilité de ces hypothèses.
Pourtant, considérer que le « juste » fonde le « légal » impose que ce « légal » ne puisse se définir de manière autoréférentielle. Tel a d’ailleurs été le jugement de la cour constitutionnelle allemande, qui a été très clair dans son arrêt du 30 juin 2009. Dans ce dernier, constatant l’inexistence d’un « peuple européen », la cour arrêtait que le droit national primait, en dernière instance, sur le droit communautaire sur les questions budgétaires. Il est important de comprendre que, pour la cour de Karlsruhe, l’UE reste une organisation internationale dont l’ordre est dérivé, car les États demeurent les maîtres des traités, étant les seuls à avoir un réel fondement démocratique. Or, les États sont aujourd’hui, et pour longtemps encore, des États-Nations. C’est la souveraineté qu’ils ont acquise qui leur donne ce pouvoir de « dire le juste ». Bien sûr, un État souverain peut être « injuste », ou en d’autres termes illégitime. Mais un État qui ne serait plus pleinement souverain ne peut produire le « juste ». De ce point de vue, la souveraineté fonde la légitimité même si cette dernière ne s’y réduit pas.
Ceci permet de comprendre pourquoi il faudra revenir sur ces trois notions, Souveraineté, Légitimité et Légalité, à la fois du point de vue de leurs conséquences sur la société mais aussi de leur hiérarchisation. Ces trois notions permettent de penser un Ordre Démocratique, qui s’oppose à la fois à l’ordre centralisé des sociétés autoritaires et à l’ordre spontané de la société de marché. Il peut d’ailleurs y avoir une hybridation entre des deux ordres, quand l’ordre planifié vient organiser de manière coercitive et non démocratique le cadre dans lequel l’ordre spontané va ensuite jouer. C’est d’ailleurs très souvent le cas dans la construction de l’Union européenne dont la légalité est de plus en plus autoréférentielle. La notion d’Ordre Démocratique assise sur la hiérarchisation des Souveraineté, Légitimité et Légalité aboutit à une critique profonde et radicale des institutions européennes. Mais le problème ne s’arrête pas là. En effet, il nous faut aussi penser ces trois notions hors de toute transcendance et de toute aporie religieuse, car la société française, comme toutes les sociétés modernes, est une société hétérogène du point de vue des croyances religieuses et des valeurs. C’est pourquoi, d’ailleurs, la « chose commune », la Res Publica, est profondément liée à l’idée de laïcité, comprise non comme persécution du fait religieux mais comme cantonnement de ce dernier à la sphère privée. Voici qui permet de remettre à sa juste place le débat sur la laïcité. Cela veut aussi dire que la séparation entre sphère privée et sphère publique doit être perçue comme constitutive de la démocratie, et indique tous les dangers qu’il y a à vouloir faire disparaître cette séparation. Mais, parce qu’il a renié les principes de cette dernière, parce qu’il vit en réalité dans l’idéologie du post-démocratique, notre Président est bien le dernier qui ait le droit de s’en offusquer.
Jacques Sapir (RussEurope, 12 janvier 2014)
Notes :